 L’étude des victoires des luttes écologistes pendant une période politiquement morose peut paraitre décalée, voire naïve. Pourtant, comprendre ces victoires peut fournir des informations essentielles sur des formes d’organisations, des tactiques et des stratégies qui ont fait leurs preuves. Avec l’association française Terres de Luttes et la revue Silence, nous avons donc conduit une enquête sociologique ( disponible intégralement sur https://terresdeluttes.fr/) auprès de 42 collectifs ayant obtenu une victoire entre 2014 et 2024
L’étude des victoires des luttes écologistes pendant une période politiquement morose peut paraitre décalée, voire naïve. Pourtant, comprendre ces victoires peut fournir des informations essentielles sur des formes d’organisations, des tactiques et des stratégies qui ont fait leurs preuves. Avec l’association française Terres de Luttes et la revue Silence, nous avons donc conduit une enquête sociologique ( disponible intégralement sur https://terresdeluttes.fr/) auprès de 42 collectifs ayant obtenu une victoire entre 2014 et 2024
 Alors que les initiatives et les combats du Mouvement ouvrier chrétien ont toujours été menés par et pour les classes populaires, force est de constater qu’aujourd’hui cette notion de classes ne relève plus de l’évidence. Un doute s’est installé sur qui compose les classes populaires, qui s’y reconnait encore, dans un contexte où la lutte politique à mener au nom d’intérêts de classe semble un combat dépassé. À l’occasion de la parution d’une enquête FTU sur les usages de la notion de classes sociales au sein de différentes organisations constitutives du MOC, nous proposons quelques réflexions qui invitent à une mise en perspective historique de la fonction politique de cette notion de classes sociales.
Alors que les initiatives et les combats du Mouvement ouvrier chrétien ont toujours été menés par et pour les classes populaires, force est de constater qu’aujourd’hui cette notion de classes ne relève plus de l’évidence. Un doute s’est installé sur qui compose les classes populaires, qui s’y reconnait encore, dans un contexte où la lutte politique à mener au nom d’intérêts de classe semble un combat dépassé. À l’occasion de la parution d’une enquête FTU sur les usages de la notion de classes sociales au sein de différentes organisations constitutives du MOC, nous proposons quelques réflexions qui invitent à une mise en perspective historique de la fonction politique de cette notion de classes sociales.
 La recherche réalisée par le Réseau Interculturel Féministe et Intersectionnel (RIFI) composé d’associations et de partenaires académiques a pour objectif d’identifier les besoins des professionnel·les pour accompagner les femmes migrantes à l’intersection des oppressions, et particulièrement du racisme, du sexisme et du classisme. Pour ce faire, l’étude a tenté de mettre à jour les difficultés rencontrées par ces femmes multiminorisées ainsi que celles vécues par les professionnel·les qui les accompagnent, les freins et les leviers dans leur travail ainsi que les stratégies qu’ils·elles mettent en œuvre pour répondre aux besoins et aux attentes des femmes auprès de qui ils·elles interviennent.
La recherche réalisée par le Réseau Interculturel Féministe et Intersectionnel (RIFI) composé d’associations et de partenaires académiques a pour objectif d’identifier les besoins des professionnel·les pour accompagner les femmes migrantes à l’intersection des oppressions, et particulièrement du racisme, du sexisme et du classisme. Pour ce faire, l’étude a tenté de mettre à jour les difficultés rencontrées par ces femmes multiminorisées ainsi que celles vécues par les professionnel·les qui les accompagnent, les freins et les leviers dans leur travail ainsi que les stratégies qu’ils·elles mettent en œuvre pour répondre aux besoins et aux attentes des femmes auprès de qui ils·elles interviennent.

Lors de sa Semaine sociale 2022, le MOC a organisé un « tribunal de la social- démocratie». Dans ce procès, Matteo Geyssens, militant aux JOC et coordinateur de projets au Ciep du MOC, participait en tant que témoin à charge. Il vient de nous quitter, beaucoup trop tôt. En hommage, nous reproduisons ses mots engagés dans ce numéro.
 À l’occasion de la rentrée politique du MOC, sa présidente Ariane Estenne a convié Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe pour repenser plus profondément, plus globalement et plus radicalement les fondamentaux de la démocratie. Ils élaborent une histoire et une philosophie de la démocratie, pour mieux comprendre ses fondements historiques et ses (dys) fonctionnements contemporains. Une discussion féconde dans un contexte d’élections qui arrivent.
À l’occasion de la rentrée politique du MOC, sa présidente Ariane Estenne a convié Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe pour repenser plus profondément, plus globalement et plus radicalement les fondamentaux de la démocratie. Ils élaborent une histoire et une philosophie de la démocratie, pour mieux comprendre ses fondements historiques et ses (dys) fonctionnements contemporains. Une discussion féconde dans un contexte d’élections qui arrivent.
 Le plan air-climat-énergie (PACE 2030) wallon a été adopté le 21 mars 2023. Ce plan d’actions constitue la feuille de route de la Wallonie pour atteindre en 2030 ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Il engage aussi la Wallonie à doubler la production d’énergies renouvelables, à améliorer la qualité de l’air et à réduire la précarité énergétique. Décryptage à l’aune de la transition juste telle qu’elle a été définie par la Confédération européenne des syndicats.
Le plan air-climat-énergie (PACE 2030) wallon a été adopté le 21 mars 2023. Ce plan d’actions constitue la feuille de route de la Wallonie pour atteindre en 2030 ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Il engage aussi la Wallonie à doubler la production d’énergies renouvelables, à améliorer la qualité de l’air et à réduire la précarité énergétique. Décryptage à l’aune de la transition juste telle qu’elle a été définie par la Confédération européenne des syndicats.
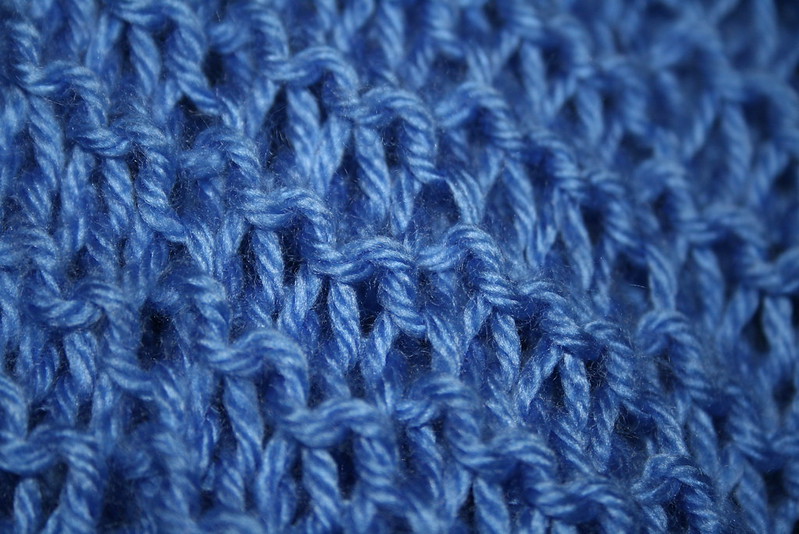 Dans son dernier ouvrage, le sociologue français Serge Paugam s’interroge sur ce qui nous relie aux autres. En prolongeant les travaux d’Émile Durkheim, il questionne les différents régimes d’attachement social. Il se montre inquiet quant à l’évolution de nos sociétés, gagnées par l’isolement au travail, mais il voit aussi s’y exprimer vigoureusement un désir de justice sociale.
Dans son dernier ouvrage, le sociologue français Serge Paugam s’interroge sur ce qui nous relie aux autres. En prolongeant les travaux d’Émile Durkheim, il questionne les différents régimes d’attachement social. Il se montre inquiet quant à l’évolution de nos sociétés, gagnées par l’isolement au travail, mais il voit aussi s’y exprimer vigoureusement un désir de justice sociale.
 Le 22 mai 2023, les organisations syndicales appelaient à manifester pour dénoncer les attaques sévères portées au droit de grève. En toile de fond de cette action, l’immixtion brutale de la Justice dans le conflit social chez Delhaize, mais aussi le récent projet de loi du ministre de la Justice Van Quickenborne (Open Vld), qui vise à assortir certaines condamnations d’une interdiction de manifester pouvant aller jusqu’à trois ans. Cette criminalisation de l’action collective relève d’une offensive politique et judiciaire de long terme contre la grève et les pratiques de protestation. Sans nier cet état de fait ni la légitimité des mobilisations syndicales en faveur du droit de grève, nous proposons un autre point de vue sur ce droit en affirmant que c’est aussi parce que la grève est un droit que sa pratique est disqualifiée socialement. L’ordre juridique (néo)libéral ne peut en effet intégrer la grève qu’à la condition de lui retirer toute capacité de transformation sociale. Dès lors, que reste-t-il de la grève ?
Le 22 mai 2023, les organisations syndicales appelaient à manifester pour dénoncer les attaques sévères portées au droit de grève. En toile de fond de cette action, l’immixtion brutale de la Justice dans le conflit social chez Delhaize, mais aussi le récent projet de loi du ministre de la Justice Van Quickenborne (Open Vld), qui vise à assortir certaines condamnations d’une interdiction de manifester pouvant aller jusqu’à trois ans. Cette criminalisation de l’action collective relève d’une offensive politique et judiciaire de long terme contre la grève et les pratiques de protestation. Sans nier cet état de fait ni la légitimité des mobilisations syndicales en faveur du droit de grève, nous proposons un autre point de vue sur ce droit en affirmant que c’est aussi parce que la grève est un droit que sa pratique est disqualifiée socialement. L’ordre juridique (néo)libéral ne peut en effet intégrer la grève qu’à la condition de lui retirer toute capacité de transformation sociale. Dès lors, que reste-t-il de la grève ?
 Le non-recours aux droits sociaux est un phénomène complexe qui touche particulièrement les femmes en situation de monoparentalité. Comme différents travaux ont pu le mettre en évidence, la monoparentalité féminine s’accompagne d’épreuves multiples 1. Dans le cadre d’une recherche que nous avons menée 2, nous avons rencontré douze femmes en situation de monoparentalité qui fréquentent l’association Vie Féminine.
Le non-recours aux droits sociaux est un phénomène complexe qui touche particulièrement les femmes en situation de monoparentalité. Comme différents travaux ont pu le mettre en évidence, la monoparentalité féminine s’accompagne d’épreuves multiples 1. Dans le cadre d’une recherche que nous avons menée 2, nous avons rencontré douze femmes en situation de monoparentalité qui fréquentent l’association Vie Féminine.

Sur plus d’un siècle d’existence, les Semaines sociales ont exploré de très nombreuses thématiques. Si leurs sujets sont éclectiques au fil des ans, elles ont à plusieurs reprises mis le focus sur la question de la démocratie culturelle et de la promotion des travailleurs et travailleuses. L’accès à la culture, à la formation et à l’Éducation permanente sont autant de revendications portées par le MOC et ses organisations, encouragés en cela par un petit groupe de militant·es actif·ves dans le mouvement et, de près ou de loin, dans l’organisation des Semaines sociales.


