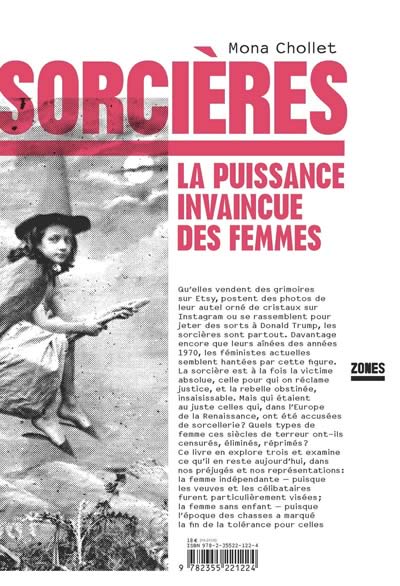 Dans cet ouvrage, l’essayiste Mona Chollet se penche comme son titre l'indique sur la figure de la sorcière. De la mauvaise femme, repoussante, hideuse, au nez crochu surmonté d’une verrue, à l’héroïne dotée de superpouvoirs, entourée d’une aura fantaisiste qui stimule l’imagination, la sorcière est le réceptacle de représentations diverses, contrastées, contraires même. Les plus négatives sont, "sans conteste, celles qui se sont forgées à la Renaissance, lorsque le mot sorcière a pris la pire des marques d’infamie et a valu aux femmes qui se voyaient attribuer cette étiquette, la torture ou la mort".
Dans cet ouvrage, l’essayiste Mona Chollet se penche comme son titre l'indique sur la figure de la sorcière. De la mauvaise femme, repoussante, hideuse, au nez crochu surmonté d’une verrue, à l’héroïne dotée de superpouvoirs, entourée d’une aura fantaisiste qui stimule l’imagination, la sorcière est le réceptacle de représentations diverses, contrastées, contraires même. Les plus négatives sont, "sans conteste, celles qui se sont forgées à la Renaissance, lorsque le mot sorcière a pris la pire des marques d’infamie et a valu aux femmes qui se voyaient attribuer cette étiquette, la torture ou la mort".
Dans Sorcière, l’auteure s’interroge sur les archétypes féminins qui se sont construits lors de ces chasses aux sorcières et qui, selon elle, sont toujours là, enfouis dans notre inconscient culturel collectif. "Les siècles de censures, d’autocensure, d’hostilité et de violence ont laissé des traces dans les représentations que nous nous faisons de la féminité". L’indépendance et le célibat des femmes, le refus de maternité, la vieillesse restent des manières contestées ou rejetées d’être femme dans un monde pétri de patriarcat et qui méprise les formes de rationalité qui prennent en compte l’émotion et l’intuition. Un monde que Mona Chollet nous invite à mettre sens dessus dessous... non pas à coup de baguette magique, mais par une réflexion savamment argumentée et documentée. À découvrir.
Mona CHOLLET, Sorcières, La puissance invaincue des femmes, Paris, La Découverte, 2018, 242 pages
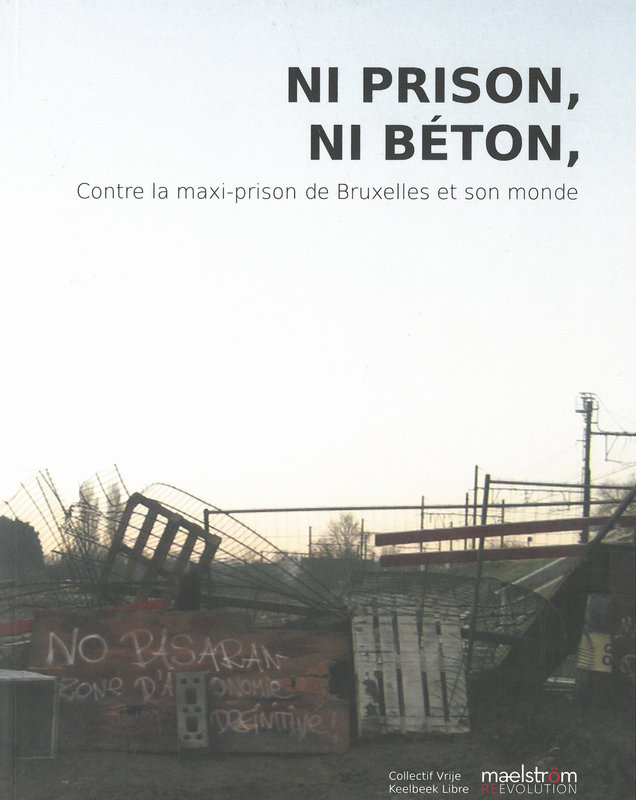 Les 16 et 17 avril derniers se tenait la 97e Semaine sociale du MOC. Intitulée « Le Mouvement social face à l’urgence écologique », elle a notamment accueilli des témoins de luttes et alternatives autour des objectifs et des modes d’action possibles pour mettre en œuvre une transition écologique. L’occasion de souligner à quel point la démocratie et le renforcement du pouvoir d’agir des hommes et des femmes sont au cœur de la transition écologique. Martin Hamoir, membre de la ZAD de Haren s’en est fait l’écho d’une manière particulièrement passionnante en témoignant de la richesse des interactions, activités, débats, formes d’entraide et luttes politiques qui fourmillent autour de la lutte pour la défense de ce quartier et de ce territoire et de la résistance au mégaprojet de prison que les autorités prévoient d’y implanter.
Les 16 et 17 avril derniers se tenait la 97e Semaine sociale du MOC. Intitulée « Le Mouvement social face à l’urgence écologique », elle a notamment accueilli des témoins de luttes et alternatives autour des objectifs et des modes d’action possibles pour mettre en œuvre une transition écologique. L’occasion de souligner à quel point la démocratie et le renforcement du pouvoir d’agir des hommes et des femmes sont au cœur de la transition écologique. Martin Hamoir, membre de la ZAD de Haren s’en est fait l’écho d’une manière particulièrement passionnante en témoignant de la richesse des interactions, activités, débats, formes d’entraide et luttes politiques qui fourmillent autour de la lutte pour la défense de ce quartier et de ce territoire et de la résistance au mégaprojet de prison que les autorités prévoient d’y implanter.
Un livre vient tout juste de paraître sur la lutte à Haren : Ni prison, ni béton. Contre la maxi-prison de Bruxelles et son monde . Il reprend une compilation des textes, tracts, photos, dessins, témoignages parus ces dix dernières années sur la lutte à Haren, ainsi que des textes et photos inédits. Résultat d’un travail collectif qui s’est étalé sur plus d’un an, ce recueil est réalisé à l’initiative de Jérôme Pelenc et avec le concours principal du comité des habitants de Haren et des membres d’une série d’associations présentes tout au long de la lutte. Pour en savoir plus sur le livre et la manière de se le procurer : http://niprisonnibetonlelivre.be/ #
Ouvrage collectif, Ni prison, ni béton. Contre la maxi-prison de Bruxelles et son monde, Bruxelles, maelstrÖm reEvolution, 2019
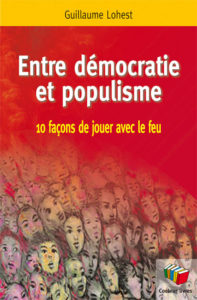 Moi, l’extrême droite, je pensais que c’était définitivement terminé, que nous avions d’autres priorités à prendre à bras-le-corps. [...] Mais je me trompais ». C’est sur cet amer constat que Guillaume Lohest entame son court – mais néanmoins dense – ouvrage Entre démocratie et populisme. Cette prise de conscience du retour de « la bête immonde » ne vient pas de nulle part. Elle est l’aboutissement d’une démarche introspective menée en août et octobre 2018. Racontée sous le format du journal, elle va de découvertes en questionnements pour établir les formes que prennent l’extrême droite et le populisme. Chez nous mais pas seulement. Au fil des jours, on voit défiler les projets de Steve Bannon contre l’Union européenne, les rapprochements suspicieux entre Poutine et l’extrême droite autrichienne, la vitalité retrouvée du Parti Populaire de Modrikamen, la montée du fascisme en Italie, le déploiement du racisme décomplexé... Mais comment éviter la propagation de ce climat fasciste et populiste ? L’auteur propose en seconde partie du livre une liste de pièges à éviter. Des pièges qui nous concernent tou·te·s, y compris à gauche, dans le camp des progressistes et chez ceux·celles qui se pensent indépendant·e·s du problème. Car de son aveu même, il suggère un regard impertinent sur toute une série de postures, d’attitudes, de discours apparemment prodémocratiques qui seraient en fait susceptibles de participer, sans doute sans le vouloir, à l’affaiblissement de la démocratie. Un livre qui résonne comme une mise en alerte des consciences et qui intéressera tou·te·s ceux.celles pour qui la démocratie n’est pas un acquis définitif et immuable...
Moi, l’extrême droite, je pensais que c’était définitivement terminé, que nous avions d’autres priorités à prendre à bras-le-corps. [...] Mais je me trompais ». C’est sur cet amer constat que Guillaume Lohest entame son court – mais néanmoins dense – ouvrage Entre démocratie et populisme. Cette prise de conscience du retour de « la bête immonde » ne vient pas de nulle part. Elle est l’aboutissement d’une démarche introspective menée en août et octobre 2018. Racontée sous le format du journal, elle va de découvertes en questionnements pour établir les formes que prennent l’extrême droite et le populisme. Chez nous mais pas seulement. Au fil des jours, on voit défiler les projets de Steve Bannon contre l’Union européenne, les rapprochements suspicieux entre Poutine et l’extrême droite autrichienne, la vitalité retrouvée du Parti Populaire de Modrikamen, la montée du fascisme en Italie, le déploiement du racisme décomplexé... Mais comment éviter la propagation de ce climat fasciste et populiste ? L’auteur propose en seconde partie du livre une liste de pièges à éviter. Des pièges qui nous concernent tou·te·s, y compris à gauche, dans le camp des progressistes et chez ceux·celles qui se pensent indépendant·e·s du problème. Car de son aveu même, il suggère un regard impertinent sur toute une série de postures, d’attitudes, de discours apparemment prodémocratiques qui seraient en fait susceptibles de participer, sans doute sans le vouloir, à l’affaiblissement de la démocratie. Un livre qui résonne comme une mise en alerte des consciences et qui intéressera tou·te·s ceux.celles pour qui la démocratie n’est pas un acquis définitif et immuable...
Guillaume LOHEST, Entre démocratie et populisme, 10 façons de jouer avec le feu, Bruxelles, Éditions Couleur Livres, 2019
Livre disponible sur demande aux Équipes populaires, 081.73.40.86 – secrétariat@equipespopulaires.be
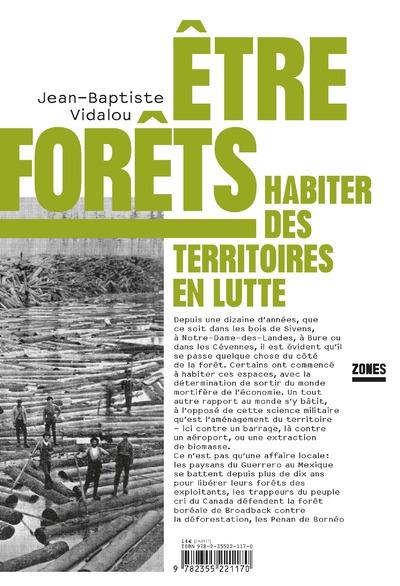 Jean-Baptiste Vidalou est agrégé de philosophie. Il est aussi bâtisseur en pierre sèche. Après plusieurs années à vivre dans les Cévennes, à deux pas de la forêt locale, il s’est lancé dans l’écriture d’un ouvrage passionnant dans lequel, à travers la forêt, il part à la rencontre de ceux et celles qui construisent un autre rapport au monde. Pour l’auteur, « il s’agit de voir comment nous sommes forêts. Des forêts qui ne seraient pas tant ce bout de nature sauvage qu’un certain alliage, une certaine composition tout à fait singulière de liens, d’êtres vivants, de magie ».
Jean-Baptiste Vidalou est agrégé de philosophie. Il est aussi bâtisseur en pierre sèche. Après plusieurs années à vivre dans les Cévennes, à deux pas de la forêt locale, il s’est lancé dans l’écriture d’un ouvrage passionnant dans lequel, à travers la forêt, il part à la rencontre de ceux et celles qui construisent un autre rapport au monde. Pour l’auteur, « il s’agit de voir comment nous sommes forêts. Des forêts qui ne seraient pas tant ce bout de nature sauvage qu’un certain alliage, une certaine composition tout à fait singulière de liens, d’êtres vivants, de magie ».
Derrière cette vision presque poétique du sujet, il y a une farouche critique de notre économie capitaliste ainsi que de notre rapport au progrès. « La dévastation du monde est devenue cet objet que l’on regarde d’"en haut", depuis nos satellites », écrit-il ainsi, pointant par exemple que « Google nous dit que la Terre aurait perdu 2,3 millions de km2 de forêts entre 2000 et 2012 ». En retraçant l’histoire de différentes forêts du globe et des luttes qui s’y mènent pour la sauvegarde du vivant, Jean-Baptiste Vidalou revendique aussi un autre rapport au territoire. Il se place dans le cadre d’« une sensibilité commune qui se bâtit contre cette science militaire qu’est l’aménagement du territoire ». Dépassant le cadre purement environnementaliste, il en profite également pour se positionner contre la transition énergétique vue par le prisme des révolutions technologiques (compteurs intelligents, objets connectés...) qui réduisent tout à de l’économie.
Un livre iconoclaste qui apporte un regard différent mais riche sur les grands débats climatiques et écologiques du moment.
Jean-Baptiste VIDALOU, Être forêts. Habiter des territoires en lutte, Paris, Éditions La Découverte, 2017, 202 pages
 Le constat de l’essayiste français Benoît Borrits est clair. Pour lui, la gauche n’a plus de projet de dépassement du capitalisme. Dans Au-delà de la propriété, l’auteur explique ainsi que la gauche a échoué à imposer la propriété collective des moyens de production, que ce soit via l’étatisation ou le modèle coopératif. Le premier de ces modèles implique une concentration du pouvoir excluant ceux.celles au nom de qui elle a été réalisée. L’idée de coopérative, quant à elle, montre ses limites car le capital tend la plupart du temps à reprendre le dessus en cas de succès de l’entreprise. Les échecs de ces deux grandes formes de propriété collective sont, selon Benoît Borrits, inhérents à la notion même de propriété. Il la considère comme excluante et centralisatice par nature : « Même collective, une propriété reste un instrument d’oppression ».
Le constat de l’essayiste français Benoît Borrits est clair. Pour lui, la gauche n’a plus de projet de dépassement du capitalisme. Dans Au-delà de la propriété, l’auteur explique ainsi que la gauche a échoué à imposer la propriété collective des moyens de production, que ce soit via l’étatisation ou le modèle coopératif. Le premier de ces modèles implique une concentration du pouvoir excluant ceux.celles au nom de qui elle a été réalisée. L’idée de coopérative, quant à elle, montre ses limites car le capital tend la plupart du temps à reprendre le dessus en cas de succès de l’entreprise. Les échecs de ces deux grandes formes de propriété collective sont, selon Benoît Borrits, inhérents à la notion même de propriété. Il la considère comme excluante et centralisatice par nature : « Même collective, une propriété reste un instrument d’oppression ».
Après un nécessaire aperçu historique qui met en lumière les différents échecs de ces expérimentations, l’auteur s’attaque aux solutions. Celles-ci passent par les « communs », à savoir des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Il promeut aussi d’autres types d’entreprises, parmi lesquelles des coopératives qui appartiennent aux travailleur.euse.s, supervisées par les usager.ère.s. Des coopératives qui échappent aux lois du marché et qui doivent s’inscrire dans un autre système économique, plus socialisé et une autre forme de démocratie, ancrée dans des expériences concrètes. Selon Benoît Borrits, c’est l’articulation de ces différents communs qui permet d’envisager la disparition totale de la propriété productive.
Des idées séduisantes qui révèlent toutefois un impensé : la manière concrète d’arriver à cette économie des communs.
Benoît BORRITZ, Au-delà de la propriété. Pour une économie des communs, Paris, La Découverte, 2018, 250 pages
 Enfin traduit en français, La Théorie du Donut de Kate Raworth est une invitation à déconstruire notre façon de penser (et surtout d’enseigner) l’économie, et à se défaire des cadres de pensée, images et graphiques qui ont été enseignés au cours des 150 dernières années. Selon Raworth, il est indispensable de sortir du cadrage unique enseigné aux milliers d’étudiants en économie de par le monde.
Enfin traduit en français, La Théorie du Donut de Kate Raworth est une invitation à déconstruire notre façon de penser (et surtout d’enseigner) l’économie, et à se défaire des cadres de pensée, images et graphiques qui ont été enseignés au cours des 150 dernières années. Selon Raworth, il est indispensable de sortir du cadrage unique enseigné aux milliers d’étudiants en économie de par le monde.
Pour cela, Raworth propose l’image du « donut ». Cette théorie s’articule autour de sept idées. Premièrement : il faut changer de but, à savoir, satisfaire les droits humains de chaque individu, dans les limites des moyens de notre planète plutôt qu’en rechercher à tout prix la croissance. Une pensée régénérative avec une vue d’ensemble du « tableau », réencastrant l’économie dans la société et l’écosystème, évitant sa dégradation. La création d’une économie circulaire permettrait aux humains de redevenir des participants à part entière dans les processus cycliques de la vie sur Terre.
La Théorie du Donut passe aussi par le fait de se départir des images fondées sur des idées erronées ou simplifiées à outrance comme l’image de l’homo œconomicus rationnel et égoïste qui ne reflète pas le fait que nous sommes des êtres aux valeurs fluides et dépendants du monde vivant. Parallèlement, les inégalités ne doivent pas être vues comme inéluctables ou faisant partie du système : c’est la redistribution des richesses (plutôt que des revenus) qui doit être recherchée. Enfin, nous avons besoin non pas d’une économie qui croisse mais d’une économie qui nous épanouisse.
La Théorie du Donut est donc, plus qu’une prescription de mesures, un appel à s’emparer des idées émergentes pour une économie du 21e siècle capable d’analyser un système complexe.
Kate RAWORTH, La théorie du donut, Paris, Plon, 2018, 432 pages


