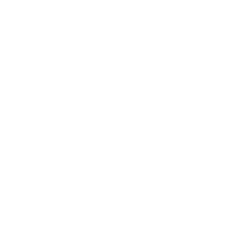En 1990, le Carhop publiait dans sa collection les « Outils pédagogiques pour l’histoire du mouvement ouvrier en Belgique », un neuvième volume intitulé « Syndicalisme au féminin » qui tentait d’analyser l’action du mouvement syndical face à la présence bien concrète des travailleuses. Comment la question de leur intégration s’est-elle posée ? Quelles réponses a-t-il apportées ? Mais aussi comment les travailleuses se sont-elles organisées pour faire entendre leurs positions ? Avaient-elles été réellement allergiques à l’organisation syndicale comme le discours dominant le laisse si souvent penser ?
Le projet était, à l’époque, très ambitieux vu le peu de travaux disponibles sur le travail des femmes en général et encore moins sur les rapports entre syndicalisme et féminisme. Aujourd’hui, nous nous sommes attelées à la réécriture de « Syndicalisme au féminin » qui est édité en deux volumes. Le premier retrace l’évolution de la question féminine au sein du mouvement ouvrier depuis les premières initiatives ouvrières jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le second (à paraître) traitera de l’organisation syndicale des femmes après la Seconde Guerre mondiale.
L’analyse des premières formes de syndicalisation, héritières des organisations professionnelles préindustrielles, entérine le principe de l’exclusion des femmes comme apprenties et donc comme travailleuses qualifiées. Leur statut est celui d’aidantes sauf en situation de veuvage où, dans certains cas, elles peuvent reprendre la gestion de l’affaire de feu leur époux. Dans certains de ces métiers, les travailleurs vont pendant longtemps s’opposer à l’accès des femmes à la profession. L’exemple le plus connu est celui des typographes. Malgré les innovations technologiques de la fin du XIXe siècle, malgré la volonté patronale d’embaucher des travailleuses — pour des raisons de gain de productivité et d’économie —, les travailleurs de ce secteur, héritiers de cette tradition syndicale forte, refusent toute mixité. Elle est vécue comme une menace pour leur propre statut et est synonyme de baisse salariale. Par contre, ils acceptent des femmes à des postes secondaires. Embaucher des margeuses est donc plus intéressant que des jeunes apprentis qui sont des concurrents potentiels. Ce syndicalisme corporatiste est paradoxal. D’un côté, il se mobilise pour soutenir les travailleuses en grève et exiger des augmentations de salaire et, de l’autre, déclare la grève — parfois générale — pour s’opposer à leur embauche à des postes mieux rémunérés et plus qualifiés.
Les travailleuses ont-elles fait grève au XIXe siècle ? L’iconographie les met en scène lors des émeutes sociales de 1886. Nous les repérons, grâce souvent à leur prénom, dans les parfois très longues listes des condamné(e)s en justice, en application de l’article 310 du Code pénal ou comme victimes de lock-out. À la fin du XIXe siècle, l’Office de l’industrie et du travail produit les premières statistiques sur les grèves. Si le premier volume ne distingue pas les hommes des femmes, les suivants comptabilisent les grévistes en fonction de leur sexe et en fonction du nombre de travailleurs et travailleuses dans l’entreprise 2. Le dépouillement des journaux syndicaux nous permet de repérer les ouvrières voire la militante qui a pris l’initiative d’arrêter le travail. Souvent, des informations trouvées par ailleurs sur l’entreprise en grève nous indiquent que la majorité des salariés, vu la très forte sexualisation des postes de travail, sont des travailleuses. L’usage général du masculin ou du neutre occulte régulièrement la présence de femmes et nous oblige, dans la lecture de nos sources, à une constante vigilance. Pour sortir de cette invisibilité, écrire systématiquement au féminin et au masculin quand des hommes et des femmes sont concernés est essentiel. Si notre ouvrage ne servait qu’à cela, ce serait déjà très positif.
Le mouvement syndical féminin tout comme le syndicalisme ouvrier et employé connaît des phases d’expansion et de récession. Il évolue en parallèle avec le contexte politique, économique et social de son temps. La législation, et plus particulièrement les mesures qui visent les femmes, a un impact direct sur leur adhésion ou non au syndicat. Pour la période étudiée, 1830-1940, elles ne s’inscrivent pas nécessairement dans le sens de l’égalité, de plus de droits ou de leur autonomie. Elles ont plutôt tendance à vouloir retirer les travailleuses du marché du travail. C’est le cas de la législation qui interdit aux femmes le travail de fond de la mine ou le travail de nuit. Ces mesures sont contestées par certaines 3, sans beaucoup de succès d’ailleurs, et par certains patrons qui ne trouvent pas de main-d’œuvre de qualité équivalente pour les remplacer, par exemple les nettoyeuses de lampes dans les charbonnages ! L’assurance-chômage au lendemain de la Première Guerre mondiale est un autre exemple d’exclusion des femmes des bienfaits de la loi. Ce phénomène, largement décrit par Hedwige Peemans-Poullet à propos des mutualités et de la protection sociale des femmes 4, aura des conséquences graves sur leur engagement syndical : pourquoi payer une cotisation syndicale, relativement beaucoup plus élevée que celle des hommes en regard de leur salaire, si elles n’en perçoivent pas les mêmes avantages ? Les organisations syndicales participent à ces débats, soutiennent ou s’opposent à ces décisions. Les positions évoluent aussi avec le temps, mais tout cela est très lent.
En général, les industriels apprécient la main-d’œuvre féminine pour des postes situés en amont et en aval de la production, tant pour les qualités dites « naturelles » des femmes (rapidité, docilité, précision) que pour l’économie salariale que représente leur embauche. Dans l’usine, la ségrégation des sexes est forte, pour des raisons de moralité, mais aussi comme méthode pour maintenir le différentiel dans les barèmes. Les fonctions mixtes sont rares et ne concernent souvent que les jeunes. Très vite, le destin des garçons et des filles se différencie. Pour les premiers, la période d’apprentissage est suivie par une montée dans les fonctions et dans l’échelle salariale. Les secondes sont attelées à des tâches d’exécutantes, sans accès à aucune qualification et sans promotion possible. Si les gamins sont parfois de passage dans les ateliers féminins, les gamines, elles, sont censées être de passage dans l’usine en attendant le mariage. C’est pour longtemps une pierre d’achoppement dans l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le discours syndical a beau la prôner et la brandir comme une valeur essentielle à respecter, mais dans le concret des qualifications et des fonctions, cela s’avère un leurre ou un objectif très improbable uniquement atteint dans l’entre-deux-guerres dans la fonction publique. Mais d’autres mécanismes se mettent alors en place pour continuer à maintenir cette différenciation par le biais de la hiérarchie des postes et par les fonctions, accessibles ou non aux femmes, avec heureusement quelques exceptions.
Les travailleuses sont bien présentes dans les ateliers. Mais il faut distinguer les groupes auxquels elles appartiennent. Les discours et stratégies qui les concernent ne seront pas les mêmes. Il y a d’une part, les enfants et les adolescentes. Dans la classe ouvrière, dans le milieu populaire en général, il est normal que les jeunes filles entrent en service, aident dans l’atelier familial ou se fassent embaucher à l’usine. À l’âge adulte, les célibataires ont un statut particulier. Le droit de travailler ne leur a été que rarement contesté. Ce sont les épouses et surtout les mères d’enfants en bas âge qui doivent rester au foyer. C’est là l’accomplissement de leur destin naturel, la famille. D’idéal à atteindre à la fin du XIXe siècle, le modèle devient dominant au vingtième et s’impose comme le seul admissible, même pour la classe ouvrière. Il envahit tous les discours, socialistes ou chrétiens, mais la justification n’est pas la même. Pour les premiers, la société socialiste permettra l’égalité de l’homme et de la femme, dans les rôles pour lesquels la nature les a destinés. Pour les seconds, l’État social-chrétien assigne des rôles différents et prédestinés aux hommes et aux femmes, avec la figure forte de Joseph et de Marie : au premier, le travail, à la seconde, la procréation. Les valeurs patriarcales et le modèle bourgeois de la famille trouvent ainsi une justification. Ce discours idéologique fort sert de toile de fond à notre récit et il est nécessaire de l’avoir à l’esprit en permanence pour comprendre les positions des syndicalistes face au travail féminin : défendre les droits et les salaires des travailleuses et en même temps, exiger des protections particulières voire leur retrait du travail pour un « retour » au foyer.
Dès le début du mouvement socialiste, quelques figures, comme l’ouvrière Émilie Claeys, nous donnent un modèle fort de l’engagement politique et féministe. Avec le temps, les militantes se font plus nombreuses dans l’action politique, dans le mouvement des femmes prévoyantes socialistes voire dans le syndicat. Elles sont employées, secrétaires, institutrices, inspectrices, ouvrières dans l’industrie textile, entre autres. Elles se font repérer par leur centrale, se font connaître dans leur fédération et par leur réseau familial. Elles sont mandatées par le syndicat dans les congrès nationaux et internationaux. Il ne s’agit pas, pour elles, de prendre des initiatives ou des positions qui n’ont pas l’aval de l’organisation syndicale, relativement conservatrice en matière des femmes. Mais rien ne dit qu’elles sont dupes et qu’elles n’arrondissent pas les angles de leurs positions pour être tout simplement audibles. D’autres osent une certaine autonomie de parole. Nous voyons émerger des personnalités comme Tine Hannick, ouvrière textile, ou Émilienne Brunfaut 5. L’une et l’autre saisissent toutes les occasions qui leur sont offertes pour rappeler aux responsables syndicaux leurs engagements ou leurs non-engagements. Quel pouvoir ont-elles eu ? C’est difficile à mesurer, mais elles donnent de la voix, rappellent régulièrement les contraintes qui pèsent sur les travailleuses, les inégalités dont elles sont victimes, les omissions qui les frappent lors des négociations paritaires. Elles mettent les négociateurs face à leurs responsabilités. Elles peuvent parfois compter sur des solidarités dans leur centrale, dans leur fédération, dans le mouvement ouvrier en général, mais elles rencontrent aussi des détracteurs et des détractrices… Le machisme n’est pas le monopole d’un sexe.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les institutions internationales ont un impact non négligeable tant sur notre législation nationale que sur l’évolution des organisations ouvrières elles-mêmes. Ce sont des lieux où s’affrontent les visions du mouvement ouvrier, entre socialistes, chrétiens ou trade-unionistes. Les femmes n’y échappent pas. Souvent, elles reviennent de ces échanges internationaux avec des idées, des positions qui les confortent au sein de leur propre organisation nationale et leur permettent de négocier un espace ou une représentation.
(*) Dans le prochain numéro de Démocratie, Marie-Thérèse Coenen – historienne, ancienne directrice du Carhop et conseillère à la formation FOPES – se penchera sur les femmes et le monde syndical chrétien.
(1) Vu mes fonctions à la FOPES et à l’Institut Cardijn, cette recherche n’aurait pas été possible sans l’aide de Florence Loriaux et de Rina Janssens pour la préparation du manuscrit et de toute l’équipe du Carhop, pour les recherches en archives et les autres tâches que suppose l’édition d’un tel ouvrage.
(2) Depuis longtemps, le mouvement féministe réclame à grands cris des statistiques ventilées selon le genre. En Europe, l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes fait la même recommandation. Il semble que dans de nombreux domaines, cela soit trop compliqué de modifier les programmes informatiques !
(3) Le métier de correctrice dans la presse quotidienne est une fonction qualifiée bien payée qui nécessite le travail de nuit. Les correctrices en seront désormais exclues. Avant la Première Guerre mondiale, le patronat, qui utilise du personnel féminin de nuit, va user de tout son pouvoir pour retarder le plus possible l’application intégrale de la loi. Après 1918, des exceptions seront admises pour des métiers spécifiquement féminins comme les infirmières, par exemple.
(4) « Histoire d’un pouvoir pris, puis confisqué : l’expérience des mutualités de femmes en Belgique », dans Stoffel S. (dir.) Femmes et pouvoirs, Bruxelles, Université des Femmes, 2007, pp. 227-242 (Collection Pensées féministes).
(5) Les archives d’Émilienne Brunfaut sont désormais déposées à l’AMSAB. Cet apport éclaire d’un jour nouveau l’action des femmes au sein du mouvement syndical socialiste surtout pour l’après-guerre 40. Ce sera l’objet du second volume.
(6) Jacques C., Les mouvements féministes en Belgique de l’entre-deux-guerres aux années 1960. L’action parlementaire de deux féministes dans Stoffel S., Femmes et pouvoirs, p. 125-137. Catherine Jacques vient de défendre sa thèse sur les mouvements féministes en Belgique de l’entre-deux-guerres aux années 1960. Nous attendons avec impatience sa publication.
Le projet était, à l’époque, très ambitieux vu le peu de travaux disponibles sur le travail des femmes en général et encore moins sur les rapports entre syndicalisme et féminisme. Aujourd’hui, nous nous sommes attelées à la réécriture de « Syndicalisme au féminin » qui est édité en deux volumes. Le premier retrace l’évolution de la question féminine au sein du mouvement ouvrier depuis les premières initiatives ouvrières jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le second (à paraître) traitera de l’organisation syndicale des femmes après la Seconde Guerre mondiale.
L’analyse des premières formes de syndicalisation, héritières des organisations professionnelles préindustrielles, entérine le principe de l’exclusion des femmes comme apprenties et donc comme travailleuses qualifiées. Leur statut est celui d’aidantes sauf en situation de veuvage où, dans certains cas, elles peuvent reprendre la gestion de l’affaire de feu leur époux. Dans certains de ces métiers, les travailleurs vont pendant longtemps s’opposer à l’accès des femmes à la profession. L’exemple le plus connu est celui des typographes. Malgré les innovations technologiques de la fin du XIXe siècle, malgré la volonté patronale d’embaucher des travailleuses — pour des raisons de gain de productivité et d’économie —, les travailleurs de ce secteur, héritiers de cette tradition syndicale forte, refusent toute mixité. Elle est vécue comme une menace pour leur propre statut et est synonyme de baisse salariale. Par contre, ils acceptent des femmes à des postes secondaires. Embaucher des margeuses est donc plus intéressant que des jeunes apprentis qui sont des concurrents potentiels. Ce syndicalisme corporatiste est paradoxal. D’un côté, il se mobilise pour soutenir les travailleuses en grève et exiger des augmentations de salaire et, de l’autre, déclare la grève — parfois générale — pour s’opposer à leur embauche à des postes mieux rémunérés et plus qualifiés.
1864-1874 : compagnes silencieuses ?
La littérature publiée sur la Première Internationale en Belgique nous donne l’occasion de repérer quelques travailleuses qui se mobilisent et investissent ce grand mouvement social. Dans les meetings et les assemblées, elles sont présentes, mais anonymes. Parfois, une se lève pour faire une quête de solidarité. Ailleurs, c’est une aubergiste qui accueille leurs réunions, malgré les risques encourus. L’une ou l’autre prennent parfois la parole. Les sections gantoise et verviétoise sont des exceptions : là, nous voyons une Marie Mineur organiser des assemblées de femmes. Les travailleuses du textile seront, pour longtemps, l’avant-garde du syndicalisme féminin.Les travailleuses ont-elles fait grève au XIXe siècle ? L’iconographie les met en scène lors des émeutes sociales de 1886. Nous les repérons, grâce souvent à leur prénom, dans les parfois très longues listes des condamné(e)s en justice, en application de l’article 310 du Code pénal ou comme victimes de lock-out. À la fin du XIXe siècle, l’Office de l’industrie et du travail produit les premières statistiques sur les grèves. Si le premier volume ne distingue pas les hommes des femmes, les suivants comptabilisent les grévistes en fonction de leur sexe et en fonction du nombre de travailleurs et travailleuses dans l’entreprise 2. Le dépouillement des journaux syndicaux nous permet de repérer les ouvrières voire la militante qui a pris l’initiative d’arrêter le travail. Souvent, des informations trouvées par ailleurs sur l’entreprise en grève nous indiquent que la majorité des salariés, vu la très forte sexualisation des postes de travail, sont des travailleuses. L’usage général du masculin ou du neutre occulte régulièrement la présence de femmes et nous oblige, dans la lecture de nos sources, à une constante vigilance. Pour sortir de cette invisibilité, écrire systématiquement au féminin et au masculin quand des hommes et des femmes sont concernés est essentiel. Si notre ouvrage ne servait qu’à cela, ce serait déjà très positif.
Le mouvement syndical féminin tout comme le syndicalisme ouvrier et employé connaît des phases d’expansion et de récession. Il évolue en parallèle avec le contexte politique, économique et social de son temps. La législation, et plus particulièrement les mesures qui visent les femmes, a un impact direct sur leur adhésion ou non au syndicat. Pour la période étudiée, 1830-1940, elles ne s’inscrivent pas nécessairement dans le sens de l’égalité, de plus de droits ou de leur autonomie. Elles ont plutôt tendance à vouloir retirer les travailleuses du marché du travail. C’est le cas de la législation qui interdit aux femmes le travail de fond de la mine ou le travail de nuit. Ces mesures sont contestées par certaines 3, sans beaucoup de succès d’ailleurs, et par certains patrons qui ne trouvent pas de main-d’œuvre de qualité équivalente pour les remplacer, par exemple les nettoyeuses de lampes dans les charbonnages ! L’assurance-chômage au lendemain de la Première Guerre mondiale est un autre exemple d’exclusion des femmes des bienfaits de la loi. Ce phénomène, largement décrit par Hedwige Peemans-Poullet à propos des mutualités et de la protection sociale des femmes 4, aura des conséquences graves sur leur engagement syndical : pourquoi payer une cotisation syndicale, relativement beaucoup plus élevée que celle des hommes en regard de leur salaire, si elles n’en perçoivent pas les mêmes avantages ? Les organisations syndicales participent à ces débats, soutiennent ou s’opposent à ces décisions. Les positions évoluent aussi avec le temps, mais tout cela est très lent.
Nouveaux métiers
L’industrialisation des processus de fabrication et la mécanisation des tâches ouvrent la porte des ateliers et des bureaux aux femmes. Alors qu’au début du XIXe siècle, peu de métiers leur sont accessibles, à l’aube du XXe siècle, nous les retrouvons dans bon nombre d’entreprises. Mais il est des secteurs où elles ne pénètrent pas : le bâtiment, la métallurgie lourde, le débardage dans les ports, les carrières… Dans l’industrie minière, nous assistons, sous prétexte de moralité et de protection de leur santé reproductive, à leur élimination progressive sauf à certains postes (triage, nettoyage des lampes et des installations) où elles sont assimilées à des gamins et des vieillards, avec un salaire correspondant !En général, les industriels apprécient la main-d’œuvre féminine pour des postes situés en amont et en aval de la production, tant pour les qualités dites « naturelles » des femmes (rapidité, docilité, précision) que pour l’économie salariale que représente leur embauche. Dans l’usine, la ségrégation des sexes est forte, pour des raisons de moralité, mais aussi comme méthode pour maintenir le différentiel dans les barèmes. Les fonctions mixtes sont rares et ne concernent souvent que les jeunes. Très vite, le destin des garçons et des filles se différencie. Pour les premiers, la période d’apprentissage est suivie par une montée dans les fonctions et dans l’échelle salariale. Les secondes sont attelées à des tâches d’exécutantes, sans accès à aucune qualification et sans promotion possible. Si les gamins sont parfois de passage dans les ateliers féminins, les gamines, elles, sont censées être de passage dans l’usine en attendant le mariage. C’est pour longtemps une pierre d’achoppement dans l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le discours syndical a beau la prôner et la brandir comme une valeur essentielle à respecter, mais dans le concret des qualifications et des fonctions, cela s’avère un leurre ou un objectif très improbable uniquement atteint dans l’entre-deux-guerres dans la fonction publique. Mais d’autres mécanismes se mettent alors en place pour continuer à maintenir cette différenciation par le biais de la hiérarchie des postes et par les fonctions, accessibles ou non aux femmes, avec heureusement quelques exceptions.
Les travailleuses sont bien présentes dans les ateliers. Mais il faut distinguer les groupes auxquels elles appartiennent. Les discours et stratégies qui les concernent ne seront pas les mêmes. Il y a d’une part, les enfants et les adolescentes. Dans la classe ouvrière, dans le milieu populaire en général, il est normal que les jeunes filles entrent en service, aident dans l’atelier familial ou se fassent embaucher à l’usine. À l’âge adulte, les célibataires ont un statut particulier. Le droit de travailler ne leur a été que rarement contesté. Ce sont les épouses et surtout les mères d’enfants en bas âge qui doivent rester au foyer. C’est là l’accomplissement de leur destin naturel, la famille. D’idéal à atteindre à la fin du XIXe siècle, le modèle devient dominant au vingtième et s’impose comme le seul admissible, même pour la classe ouvrière. Il envahit tous les discours, socialistes ou chrétiens, mais la justification n’est pas la même. Pour les premiers, la société socialiste permettra l’égalité de l’homme et de la femme, dans les rôles pour lesquels la nature les a destinés. Pour les seconds, l’État social-chrétien assigne des rôles différents et prédestinés aux hommes et aux femmes, avec la figure forte de Joseph et de Marie : au premier, le travail, à la seconde, la procréation. Les valeurs patriarcales et le modèle bourgeois de la famille trouvent ainsi une justification. Ce discours idéologique fort sert de toile de fond à notre récit et il est nécessaire de l’avoir à l’esprit en permanence pour comprendre les positions des syndicalistes face au travail féminin : défendre les droits et les salaires des travailleuses et en même temps, exiger des protections particulières voire leur retrait du travail pour un « retour » au foyer.
Syndicat socialiste
À la fin du XIXe siècle, le Parti ouvrier belge (POB) décide que l’affiliation syndicale des travailleuses se fera dans les syndicats existants. L’organisation de syndicats féminins spécifiques ne lui semble pas être la solution adéquate même si la pratique témoigne de leur intérêt pour cette forme d’organisation. Les ouvrières viennent davantage à des sections féminines, animées par des militantes, pour discuter des questions qui les concernent. La lutte des classes est commune et le mouvement doit rester uni et indivisible. La syndicalisation des femmes s’avère difficile et progresse peu, mais ce constat est aussi valable pour la branche syndicale masculine, qui reste la branche « faible » du mouvement socialiste, du moins avant 1914. Alors, sans pour autant abandonner ce chantier, le Parti se tourne vers d’autres formes d’organisations telles que des ligues politiques, des cercles d’études, les mutuelles, les coopératives... pour toucher les femmes, toutes les femmes, à travers un intéressement aux « services ». Au tournant du siècle, la Fédération des femmes socialistes centralise et coordonne les diverses activités féminines sauf l’action syndicale. Celle-ci reste une prérogative de la nouvelle Commission syndicale du POB qui refuse la constitution de syndicats féminins séparés, mais reste ouverte à des collaborations ponctuelles avec la Fédération des femmes socialistes pour toutes questions relatives aux ouvrières. Dans l’entre-deux-guerres, le mouvement féminin socialiste avec le Comité national d’action féminine, touche essentiellement la ménagère, la mère, la femme au foyer. Les travailleuses sont de la compétence du syndicat. La création d’un organe syndical féminin reste longtemps une question ouverte. Les responsables syndicaux balancent en permanence entre la nécessité d’avoir un tel outil, malgré le spectre de la division des sexes, et l’assimilation des travailleuses aux structures existantes au nom de la lutte des classes et de la centralisation syndicale. Régulièrement, des militantes, des militants soulignent la nécessité d’une section féminine. Dans les années 1930, elles obtiennent la mise en place d’un comité féminin au sein de la Commission syndicale, mais il ne fonctionne pas. L’expérience se répète en 1936 avec l’installation de la première Commission du travail des femmes, mais elle disparaît également peu de temps après. Le contexte les avait portées à prendre cette décision : chômage, concurrence syndicale, représentation des intérêts féminins dans divers cercles et organes nationaux et internationaux, mais cela n’avait pas suffi pour assurer la pérennité à cette instance. Pour cela, il faut des hommes et des femmes convaincus que ce travail est nécessaire et urgent et qui soient prêts à s’y investir.Dès le début du mouvement socialiste, quelques figures, comme l’ouvrière Émilie Claeys, nous donnent un modèle fort de l’engagement politique et féministe. Avec le temps, les militantes se font plus nombreuses dans l’action politique, dans le mouvement des femmes prévoyantes socialistes voire dans le syndicat. Elles sont employées, secrétaires, institutrices, inspectrices, ouvrières dans l’industrie textile, entre autres. Elles se font repérer par leur centrale, se font connaître dans leur fédération et par leur réseau familial. Elles sont mandatées par le syndicat dans les congrès nationaux et internationaux. Il ne s’agit pas, pour elles, de prendre des initiatives ou des positions qui n’ont pas l’aval de l’organisation syndicale, relativement conservatrice en matière des femmes. Mais rien ne dit qu’elles sont dupes et qu’elles n’arrondissent pas les angles de leurs positions pour être tout simplement audibles. D’autres osent une certaine autonomie de parole. Nous voyons émerger des personnalités comme Tine Hannick, ouvrière textile, ou Émilienne Brunfaut 5. L’une et l’autre saisissent toutes les occasions qui leur sont offertes pour rappeler aux responsables syndicaux leurs engagements ou leurs non-engagements. Quel pouvoir ont-elles eu ? C’est difficile à mesurer, mais elles donnent de la voix, rappellent régulièrement les contraintes qui pèsent sur les travailleuses, les inégalités dont elles sont victimes, les omissions qui les frappent lors des négociations paritaires. Elles mettent les négociateurs face à leurs responsabilités. Elles peuvent parfois compter sur des solidarités dans leur centrale, dans leur fédération, dans le mouvement ouvrier en général, mais elles rencontrent aussi des détracteurs et des détractrices… Le machisme n’est pas le monopole d’un sexe.
Les mentalités évoluent
Alors qu’il existait au XIXe siècle des passerelles entre le mouvement socialiste et le féminisme, dans l’entre-deux-guerres, afficher un certain féminisme n’est plus de bon ton. La position féministe anti-réglementariste vis-à-vis du travail des femmes est une pierre de discorde avec le mouvement syndical, qui plaide lui, pour la protection de la mère et l’écartement des femmes de tout travail dangereux et pénible. Progressivement, certaines d’entre elles, militantes féministes, comme Isabelle Blume ou Lalla Vandervelde, vont, grâce à leur aura dans le mouvement socialiste, faire évoluer les mentalités 6. C’est perceptible en 1935 dans la position de la Commission syndicale contre l’interdiction du travail salarié des femmes mariées et le principe de liberté des femmes de travailler ou non. Le modèle idéal est l’épouse au foyer, mais certaines sont dans la nécessité de gagner leur vie, alors autant que ce soit dans de bonnes conditions et avec des salaires corrects. Il est toutefois normal de négocier en commissions paritaires des barèmes féminins largement inférieurs au salaire masculin et à peine égal à celui d’un gamin de 18 ans.Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les institutions internationales ont un impact non négligeable tant sur notre législation nationale que sur l’évolution des organisations ouvrières elles-mêmes. Ce sont des lieux où s’affrontent les visions du mouvement ouvrier, entre socialistes, chrétiens ou trade-unionistes. Les femmes n’y échappent pas. Souvent, elles reviennent de ces échanges internationaux avec des idées, des positions qui les confortent au sein de leur propre organisation nationale et leur permettent de négocier un espace ou une représentation.
(*) Dans le prochain numéro de Démocratie, Marie-Thérèse Coenen – historienne, ancienne directrice du Carhop et conseillère à la formation FOPES – se penchera sur les femmes et le monde syndical chrétien.
(1) Vu mes fonctions à la FOPES et à l’Institut Cardijn, cette recherche n’aurait pas été possible sans l’aide de Florence Loriaux et de Rina Janssens pour la préparation du manuscrit et de toute l’équipe du Carhop, pour les recherches en archives et les autres tâches que suppose l’édition d’un tel ouvrage.
(2) Depuis longtemps, le mouvement féministe réclame à grands cris des statistiques ventilées selon le genre. En Europe, l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes fait la même recommandation. Il semble que dans de nombreux domaines, cela soit trop compliqué de modifier les programmes informatiques !
(3) Le métier de correctrice dans la presse quotidienne est une fonction qualifiée bien payée qui nécessite le travail de nuit. Les correctrices en seront désormais exclues. Avant la Première Guerre mondiale, le patronat, qui utilise du personnel féminin de nuit, va user de tout son pouvoir pour retarder le plus possible l’application intégrale de la loi. Après 1918, des exceptions seront admises pour des métiers spécifiquement féminins comme les infirmières, par exemple.
(4) « Histoire d’un pouvoir pris, puis confisqué : l’expérience des mutualités de femmes en Belgique », dans Stoffel S. (dir.) Femmes et pouvoirs, Bruxelles, Université des Femmes, 2007, pp. 227-242 (Collection Pensées féministes).
(5) Les archives d’Émilienne Brunfaut sont désormais déposées à l’AMSAB. Cet apport éclaire d’un jour nouveau l’action des femmes au sein du mouvement syndical socialiste surtout pour l’après-guerre 40. Ce sera l’objet du second volume.
(6) Jacques C., Les mouvements féministes en Belgique de l’entre-deux-guerres aux années 1960. L’action parlementaire de deux féministes dans Stoffel S., Femmes et pouvoirs, p. 125-137. Catherine Jacques vient de défendre sa thèse sur les mouvements féministes en Belgique de l’entre-deux-guerres aux années 1960. Nous attendons avec impatience sa publication.