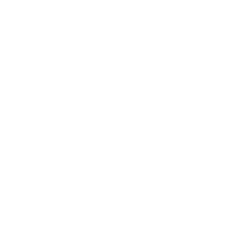Sept ans après la première enquête journalistique sur l’affaire Weinstein aux États-Unis, Reporters sans frontières consacre son rapport aux effets du mouvement #MeToo sur la couverture des questions relatives aux droits des femmes et aux violences de genre. Même si ces sujets ont davantage occupé les Unes des médias, enquêter sur les droits des femmes reste risqué.
Sept ans après la première enquête journalistique sur l’affaire Weinstein aux États-Unis, Reporters sans frontières consacre son rapport aux effets du mouvement #MeToo sur la couverture des questions relatives aux droits des femmes et aux violences de genre. Même si ces sujets ont davantage occupé les Unes des médias, enquêter sur les droits des femmes reste risqué.
Par Manon Legrand, journaliste Démocratie
«Je remercie Le Monde de m’avoir permis de mettre en Une des mots aussi tabous à l’époque que “féminicide”, “inceste”, “porno” ou “pédocriminalité”». Ces mots sont ceux de Laurène de Foucher, journaliste française salariée au Monde et récompensée le 4 décembre dernier par le prestigieux prix Albert Londres, pour ses reportages et enquêtes publiées dans le quotidien français sur l’affaire Mazan, les viols collectifs, les victimes de l’industrie du porno ou encore les viols de femmes migrantes. Dans son discours, elle souligne aussi que ce prix envoie «le signal positif que la documentation des violences masculines est un champ journalistique à part entière».
Quelques semaines plus tôt, le 22 octobre Reporters sans frontières (RSF) publiait le rapport «Le journalisme à l’ère #MeToo», bilan des transformations du paysage médiatique et des conditions de travail des journalistes qui traitent des questions de droits des femmes, depuis la première enquête journalistique sur Weinstein en 20171. Les violences masculines sont-elles aujourd’hui devenue un champ journalistique à part entière, pris au sérieux dans les rédactions ? Comment sont trait·ées les journalistes qui couvrent ces sujets ? Quelles sont les mesures que recommande RSF aux rédactions, aux États mais aussi aux plateformes pour davantage prévenir ces violences et protéger les journalistes ?
«Un printemps féministe des médias»
Le constat principal que pose l’ONG, à partir d’une enquête menée auprès de 113 journalistes implantées dans 112 pays différents, est que l’année 2017, où a éclaté le mouvement #MeToo, a constitué un «momentum médiatique international ». RSF parle de « printemps féministe des médias » pour qualifier ce tournant dans la couverture des violences de genre, tant dans la presse spécialisée que généraliste. «Plus de 80 % des journalistes sondé·es constatent une augmentation significative des sujets consacrés aux droits des femmes, aux problématiques de genre et aux violences sexistes et sexuelles », y lit-on.
Le récent rapport du collectif #NousToutes sur le traitement médiatique des féminicides entre 2017 et 20222, vient confirmer cette évolution. Il relève qu’« en 2022, il y a 28 fois plus d’articles de presse écrite mentionnant le terme “ féminicide/s ” qu’en 2017». Le rapport souligne aussi une amélioration du traitement: «En 2022, les féminicides conjugaux sont davantage traités comme des faits de société systémiques, constituant le dernier échelon du continuum des violences.»
«On voit beaucoup plus apparaitre le mot féminicide dans les médias, et certains d’entre eux ont mené de longues enquêtes sur les violences faites aux femmes, les sortant enfin de la catégorie des faits divers et les traitant comme des sujets journalistiques à part entière. C’est réjouissant», observe Camille Wernaers, journaliste pour Les Grenades, média spécifiquement dédié aux questions des droits des femmes lancé le 8 mars 2019 sur le site web de la RTBF, et pour axelle, magazine féministe créé en 1998. Mais, complète-t-elle, « comme pour toute avancée concernant les droits des femmes, il faudra rester vigilantes, afin qu’on ne reparte pas en arrière. Nous avons connu un féminicide en novembre et un en décembre qui ont tous deux été qualifiés de “drame ” ou de “drame familial ” dans de nombreux médias. » Des qualifications qui vont pourtant à l’encontre de la Recommandation sur le traitement journalistique des violences de genre adoptée par le Conseil de déontologie journalistique en 2021.
Nouveaux médias, nouvelles pratiques
Autre signe de ce « printemps féministe des médias » : la création de nouveaux médias féministes ou orientés droits des femmes et questions de genre, sans oublier la vague de médias se déployant uniquement sur les réseaux sociaux. RSF souligne aussi l’émergence de collectifs de femmes journalistes spécialement dédiés à cette question, notamment tansfrontaliers, comme le collectif Youpress, qui a publié en 2023 dans des médias français et belges l’enquête «Femmes à abattre», recensant près de 300 meurtres de femmes activistes perpétrés dans 58 pays de 2010 à 2022, parmi lesquels des journalistes.
Au rayon des effets positifis post #MeToo, RSF salue aussi l’élaboration de chartes éthiques mais aussi la mise sur pied dans plusieurs rédactions du poste de « gender editor », sur inspiration du New York Times qui a créé ce poste de responsable éditoriale chargé de veiller à la bonne représentation des femmes et des minorités de genre dans ses pages.
Si #MeToo a donné un coup de main aux journalistes et un coup de projecteurs sur les enquêtes relatives aux violences, «le traitement des violences dans la presse n’a pas commencé en 2017», précise Laurène Daycard, autrice du rapport RSF et journaliste spécialisée sur les féminicides. «C’est pourquoi nous avons rappelé l’existence de médias pionniers. Nous soulignons aussi que #MeToo est le le triomphe d’un mouvement de fond originellement imaginé par l’activiste afro-américaine Tarana Burke dès 2006 et qui déferlait déjà partout en Amérique latine et centrale depuis 2015 avec le mot d’ordre pionnier #NiUnaMenos, “Pas une de moins”, à la suite de l’assassinat de Chiara Páez, une adolescente de 14 ans par son petit ami, en 2015 en Argentine», indique l’autrice.
Réduites au silence
«Mais ce printemps féministe des médias n’est pas sans danger, souligne en prologue Thibaut Bruttin, directeur général de RSF. «Plus d’un quart des répondant·es à l’étude (27%) estiment que, dans leur pays, il est dangereux pour les journalistes de travailler sur les droits des femmes, les questions de genre et/ou les violences sexistes et sexuelles», indique RSF qui consacre la deuxième partie de son enquête à la perpétuation des exactions contre les journalistes qui traitent de ces questions.
«Menacé·es, cyberharcelé·es, des journalistes sont contraint·es à l’autocensure, voire à l’exil. D’autres font l’objet de procédures judiciaires abusives visant à les faire taire », souligne RSF, relevant aussi des disparités selon les contextes politiques, les territoires et les rédactions. «Les représailles contre les reporters pour leur travail sur les droits des femmes vont même jusqu’à l’emprisonnement, comme en Chine, où Sophia Huang Xueqin, instigatrice de #WoYeShi, le #MeToo local, a été arrêtée en 2021. En Russie, l’emprise d’un pouvoir toujours plus autoritaire se répercute sur la couverture médiatique et des journalistes témoignent avoir dû reconsidérer leur approche des violences sexistes et sexuelles. Les journalistes de nationalité afghane qui se saisissent de ces sujets doivent, quant à eux, vivre dans la clandestinité ou en exil. En Iran, les journalistes qui réalisent des enquêtes dans le sillage du mouvement “ Jin, Jiyan, Azadî ” (“ Femme, vie, liberté ”) sont sévèrement réprimé·es. »
RSF a également effectué le macabre décompte des féminicides de journalistes : «Sur les 486 journalistes tué·es dans l’exercice de leurs fonctions dans le monde depuis 2017, 40 victimes sont des femmes et au moins dix d’entre elles ont été tuées après avoir consacré une partie de leur travail aux droits des femmes et aux violences de genre.» C’est le cas notamment de Nagihan Akarsel, co-rédactrice en chef du magazine Jineologî, tuée par balles sur le pas de sa porte, au Kurdistan irakien, le 4 octobre 2022. Mais aussi de Miroslava Breach, journaliste spécialisée sur les sujets liés aux crimes organisés et aux féminicides dans la région de Ciudad Juárez au Mexique–pays le plus dangereux pour les journalistes –assassinée par arme à feu dans sa voiture le 23 mars 2017.
Cyberharcèlement
Les réseaux sociaux, porte-voix des femmes, peuvent aussi se retourner contre elles pour les faire taire. Le cyberharcèlement est l’une des violences les plus répandues, détecté dans au moins 69 pays sur les 112 représentés dans cette étude.
«En Belgique, c’est très certainement le cyberharcèlement qui est le risque le plus prégnant pour les femmes journalistes, relève aussi Camille Wernaers. Ce qui m’est arrivé plusieurs fois avec parfois des situations inquiétantes, une personne m’a notamment identifiée comme étant “ à éliminer ” sur twitter (ex-X, NDLR). Cela a des conséquences physiques et psychiques. Il y a aussi fréquemment des menaces de poursuites judiciaires.»
Plusieurs journalistes interrogées dans le rapport dénoncent des faits similaires et déplorent l’impunité du cyberharcèlement. «De nombreuses agressions sont rendues possibles par l’anonymat dont jouissent les utilisateur·es», rappelle ainsi Rosa Maria Rodriguez Quintanilla, directrice générale du Réseau international de journalistes avec une vision de genre (RIPVG), soulignant que « l’anonymat est bienvenu, surtout dans les zones de silence où les conditions ne permettent pas de s’exprimer librement, mais cet anonymat doit cesser lorsque l’utilisateur de ces réseaux sociaux viole les droits des journalistes.»
En plus d’appeler les plateformes à prendre leurs responsabilités sur cet enjeu, RSF recommande aussi d’«introduire dans le droit pénal la criminalisation de certaines formes de cyberharcèlement avec des circonstances aggravantes pour les auteurs et les responsables de ces infractions lorsque celles-ci visent des journalistes femmes et des minorités de genre».
Soutenir les femmes journalistes
Laurène Daycard rappelle que «ce combat pour un meilleur traitement médiatique des violences s’inscrit aussi dans une lutte pour plus de parité dans les rédactions». Un enjeu qui est toujours crucial pour la Belgique aussi. «Le portrait type du journaliste, un homme universitaire blanc de 47 ans, n’a quasiment pas évolué en dix ans, ce qui pose des questions en termes de pluralisme et de reflets de la diversité au sein de la société belge francophone», relève le dernier rapport de l’AJP sur la question3.
«Plus les rédactions demeurent homogènes, plus des parties du monde resteront dans l’ombre, ne seront pas traitées par les médias», déplore Camille Wernaers, qui relève aussi le soupçon de militantisme qui pèse encore trop sur les journalistes spécialisées en violences de genre et droits des femmes. «Le féminisme, pour moi, n’est pas une opinion, mais une expertise qui me permet en tant que journaliste de dévoiler les biais sexistes et de ne pas les reproduire, ou en tout cas le moins possible, dans mes articles. C’est une posture professionnelle qui nous invite à réfléchir en permanence aux mots que nous employons et aux images que nous utilisons. Quand on se pense neutre, on peut laisser passer de nombreux stéréotypes, qui sont présents dans notre société.»
Une affirmation que défend aussi le magazine axelle, magazine féministe créé il y a 26 ans. La rédaction, avec une quinzaine de journalistes, a partagé ses manières de voir et de faire dans un petit livret intitulé « brouillon 1 pour un journalisme féministe » . « Notre objectif avec ce brouillon est de montrer que les processus sont tout aussi importants que le résultat quand on veut faire un journalisme pour plus de démocratie, pour plus de respects des droits d’humains. Il s’agit de réfléchir avec les personnes qui produisent l’information, en lien avec les personnes qui témoignent – les victimes en priorité –mais aussi avec le lectorat et le reste de la société », souligne Sabine Panet, rédactrice en chef.
Ces réflexions et ces démarches sont précieuses pour faire avancer et améliorer la couverture journalistique des violences mais elles sont aussi couteuses, en temps, en énergie, en argent. «L’une des façons de museler les journalistes est de les asphyxier économiquement. Les journalistes indépendantes et les petites rédactions engagées sur ces questions sont particulièrement vulnérables», observe à ce sujet Laurène Daycard. Le développement de dispositifs d’aides financières pour mieux soutenir le travail d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles, par exemple sous la forme de bourses dédiées figure d’ailleurs au rang des recommandations que RSF adresse aux rédactions. Autant de défis pour que les journalistes puissent continuer à explorer et traiter, dans tous les recoins, ce vaste « champ journalistique à part entière », qui n’est, comme le soulignait aussi Laurène de Foucher «malheureusement pas près de disparaitre ». #
1.Le 5 octobre 2017, Jodi Kantor et Megan Twohey, journalistes du quotidien américain New York Times, publient la première enquête sur l’affaire Weinstein, producteur de cinéma accusé de violences sexuelles par des dizaines d’actrices. Le 10 octobre 2017, une seconde enquête réalisée par Ronan Farrow est publiée par The New Yorker.
2. Depuis 2022, le collectif #NousToutes effectue un décompte des féminicides en France pour représenter la réalité des violences de genre, féminicides conjugaux (compagnon ou ex-compagnon), familiaux (sphère familiale) et sociaux (commis dans l’espace social par un homme proche ou inconnu). Le féminicide est défini par le collectif comme le meurtre ou suicide forcé d’une femme en raison de son genre, et ce quels que soient son âge ou les circonstances. Les féminicides s’inscrivent dans un contexte de violences patriarcales systémiques et/ou dans un croisement avec d’autres systèmes d’oppression. Voir :www.noustoutes.org
3. G. GERMAIN (AJP), Étude de la diversité au sein de la profession de journaliste (2012-
2023), octobre 2024. Disponible sur ajp.be