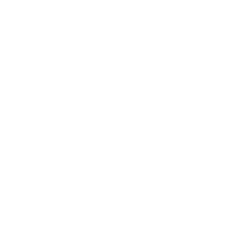La solidarité internationale est un concept indispensable dans la lutte contre les inégalités, mais sa mise en oeuvre soulève de nombreuses questions, notamment lorsqu’il s’agit de soutenir les pays du Sud dans leur quête de développement et de justice sociale. Entre promesses non tenues et pratiques de domination, comment construire une solidarité véritablement transformative ? Quel rôle les ONG doivent-elles jouer dans ce processus ? Des acteurs de la société civile congolais en visite en Belgique en mars 2024 partagent leur vision pour relever les défis d’un système mondial inégal.
La solidarité internationale est un concept indispensable dans la lutte contre les inégalités, mais sa mise en oeuvre soulève de nombreuses questions, notamment lorsqu’il s’agit de soutenir les pays du Sud dans leur quête de développement et de justice sociale. Entre promesses non tenues et pratiques de domination, comment construire une solidarité véritablement transformative ? Quel rôle les ONG doivent-elles jouer dans ce processus ? Des acteurs de la société civile congolais en visite en Belgique en mars 2024 partagent leur vision pour relever les défis d’un système mondial inégal.
Partant du constat que 85 % de la populationPartant du constat que 85 % de la population congolaise est rurale et vit de l’agriculture paysanne, de la conviction que le développement de la République démocratique du Congo sera rural ou ne sera pas, convaincus de l’impératif de la conscientisation populaire, Xavier Bashonja (membre de l’ASBL Carrefour de Réflexion Santé engagé dans le milieu ruralet minier de Buryini au Sud Kivu), Emmanuel Rugaraburaa (administrateur délégué de l’ASBL Carrefour de Réflexion Santé et ancien président de la société civile du Sud Kivu) et Adrien Zawadi, président de l’ASBL Carrefour de Réflexion Santé et Président du Bureau de la Société Civile du Sud Kivu sont engagés dans une dynamique de construction « d’ilots de développement intégral paysan ». Le levier majeur de cette dynamique est l’éducation populaire.
Son objectif est de proposer des pôles de référence qui démontrent qu’en articulant développement économique (par l’élevage, l’agriculture et la pisciculture), développement culturel (par la scolarisation des enfants, l’alphabétisation des femmes adultes) et développement social (par un meilleur accès à des soins de qualité), le pays doit pouvoir évoluer de façon plus autonome, en rupture avec une économie extravertie et extractive, qui ne profite qu’aux grandes puissances et un peu à une partie des élites locales.
Quel est votre regard sur le concept et le fonctionnement de solidarité internationale ?
Le concept de la solidarité internationale est importantet indispensable, car sans elle, le monde suivrait la loi du plus fort, où seuls les puissants s’entraident entre eux. Or, c’est précisément parce qu’il y a des plus faibles, c’est-à-dire des « sans-paroles », des exclu·es et des marginalisé·es par le système dominant, que la solidarité est essentielle. En tant que Congolais, cette solidarité nous semble cependant parfois lointaine. Malgré nos discours, nos luttes, nos vies perdues pour attirer l’attention des acteurs internationaux sur notre situation, nous n’avons pas l’impression que nos interpellations sont entendues. Nous estimons ne pas être pris en compte par cette solidarité internationale ou en tout cas pas suffisamment pourqu’elle puisse changer la donne dans notre pays.
Dans d’autres pays, comme le Sénégal, des associations locales parviennent à mieux mobiliser des ressources pour soutenir des projets de développement. En revanche, chez nous, au Congo, même les plus petites initiatives rencontrent des obstacles considérables. Les financements sont rares et lorsqu’ils arrivent, ils sont souvent accompagnés de conditions restrictives et d’exigences démesurées.Cela empêche de résoudre les problèmes de base. Le double standard qui favorise certains pays lorsqu’il y a des intérêts en jeu et en délaisse d’autres s’applique aussi à la solidarité et ce, même lorsqu’il existe desacteurs locaux prêts à s’impliquer dans des projets.
Nous estimons ne pas être pris en compte par cette solidarité internationale ou en tout cas pas suffisamment pourqu’elle puisse changer la donne dans notre pays.
Comment expliquez-vous ces difficultés que rencontre votre pays ?
Ce qui nous arrive n’est pas seulement lié à nos erreurs et à nos insuffisances. Il y a des dysfonctionnements internes, mais aussi des complicités externes. Des acteurs internes qui se trouvent parfois bien loin de nous enveniment la situation, renforcent notre précarité. Certaines élites, tant locales qu’internationales, semblent peu disposées à changer le cours de choses. Est-ce parce que notre pays possède des minerais qu’il faut le fragiliser davantage ? Est-ce parce que nous avons des problèmes de gouvernance qu’il faut se méfier de nous ? Je ne sais pas. On se sent parfois mal aimés.
Nous avons des compétences et des solutions pour changer notre milieu. Nous avons la volonté et la décision de changer. Nous avons cependant besoin de ressources et d’un environnement favorable pour mettre en oeuvre ce changement.
Quelle est alors la vision de la solidarité internationale que vous défendez ?
La solidarité est indispensable, mais elle doit être équitable et non paternaliste. Nous avons des compétences et des solutions pour changer notre milieu. Nous avons la volonté et la décision de changer. Nous avons cependant besoin de ressources et d’un environnement favorable pour mettre en oeuvre ce changement.
La solidarité que nous voulons développer et qui est essentielle à nos yeux est celle qui se construit à partir de la base. Il faut distinguer la solidarité des puissants de celle des « petits », de celles et ceux qui souffrent et qui luttent pour la dignité et l’égalité, des victimes de la solidarité détournée. Cette solidarité d’en bas est notre seule arme pour contrer le capitalisme mondial.
Aujourd’hui, le capitalisme international crée des inégalités profondes. Si nous ne nous unissons pas, sinous ne prenons pas conscience de nos forces collectives,nous n’arriverons jamais à faire face à ce système d’oppression. Comme le disait Karl Marx, « les prolétaires n’ont rien à perdre que leurs chaines ». Nous, les peuples du Sud, c’est par cette solidarité des « petits » que nous pourrons construire des résistances et peut-être un jour renverser la tendance.
Quelles sont, selon vous, les principales stratégies à suivre pour réussir à concrétiser l’action internationale dans un contexte aussi complexe ?
Nous disposons aujourd’hui de certains outils pour mener à bien nos projets, mais ce travail est un processus complexe et progressif. En premier lieu, il nous faut conscientiser la population, faire comprendre aux paysan·nes d’ici et d’ailleurs que nous faisons face aux mêmes menaces imposées par les forces capitalistes. Une fois cette prise de conscience amorcée, il s’agit de nous organiser pour passer à l’action. Notre association a produit plusieurs ouvrages1 dont un sur la pédagogie de la conscientisation qui rassemble et synthétise ces idées. C’est un travail inspiré par despersonnes qui ont bien identifié les partenaires de combat pour faire face non seulement au capitalisme,mais au système dominant plus largement.
Nous devons créer des résistances qui s’articulent et se renforcent entre elles. C’est un véritable défi dans un pays aussi vaste que le Congo où la pauvreté dans un pays aussi vaste que le Congo où la pauvreté est omniprésente. Pour organiser un mouvement puissant qui va de l’est à l’ouest et du nord au sud,il faut des moyens importants. En plus de la volonté,de la vision, l’obtention de moyens est primordiale.Par ailleurs, dans la dynamique d’en bas dont ona parlé précédemment, une autre action essentielle pour nous consiste à rester vigilants aux stratégies développées par l’opposant pour empêcher les résistances. Celles-ci consistent par exemple à allerchercher des allié·es pour nuire à la réputation de la société civile, voire à infiltrer des associations afin d’étouffer cette énergie dès ses premiers élans. Cela rend les choses encore plus complexes. #
Quel est le rôle des ONG internationales dans la mise en oeuvre des solidarités internationales ?
Par Luc Dusoulier, présidente de WSM
L’un des objectifs majeurs d’ONG comme WSM (We Social Movements) est de contribuer à l’émergence d’organisations sociales puissantes. Il n’y a pas de progrès social sans lutte et il n’y a pas de lutte efficace sans organisation puissante. À travers tout ce que l’on fait, il faut toujours avoir cet objectif : si on veut changer le rapport de forces, il faut être beaucoup plus fort. Pour y arriver, plusieurs facteurs doivent être réunis : le nombre, l’articulation des forces, la construction d’une idéologie partagée, la formation de cadres, etc. Ces éléments sont incontournables.
WSM est une ONG issue et intégrée au Mouvement ouvrier chrétien belge. À ce titre, elle est aussi l’héritière de ce formidable et puissant levier que fut et est encore l’éducation populaire. Elle s’inspire de la pédagogie initiée par Joseph Cardijn et mise en oeuvre par la JOC, ainsique de la pédagogie de la conscientisation de Paulo Freire. Cette dernière repose sur le principe fondamental que « personne ne libère autrui, les hommes et les femmes se libèrent eux-mêmes et collectivement ».
Ce principe essentiel doit être au coeur de toute relation de solidarité et de partenariat international. À défaut, les ONG et tout ce qui est mis en oeuvre dans le cadre de la coopération internationale ne constitueront au mieux qu’un paternalisme sans effets durables, et au pire une escroquerie destinée à masquer les logiques de défense prioritaire des intérêts économiques des pays « donateurs ».
Par la force des choses (la pauvreté et la rareté des ressources étant tellement fortes), nous nous trouvons immanquablement dans la posture de bailleurs financiers, avec ce que cela suppose comme ambivalence et difficultés d’instaurer de véritables relations égalitaires. C’est pourquoi la question des moyens financiers doit aussi être réfléchie. Les ONG doivent contribuer au développement, mais aussi agir dans une visée émancipatrice d’autonomisation etd’autosuffisance des populations. Chercher, avec les partenaires, chaque fois que c’est possible, les moyens de renforcer leur autonomie financière est crucial. C’est dans cet esprit que doit seconstruire la solidarité internationale.
1. É. BISIMWA GANYWA, L. DUSOULIER, E. RUGARABURA, La pédagogie de la conscientisation, une pédagogie pour l’Afrique, Weyrich Africa, Neufchâteau, 2018 et É. BISIMWA GANYWA, Par où commencer ? Une autre vision du développement pour la République démocratique du Congo, Weyrich Africa, Neufchâteau, 2018.