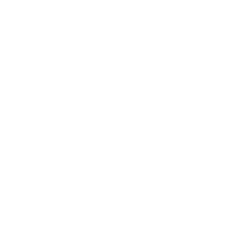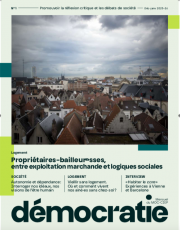Dans un contexte où la pression pour faire reprendre le travail aux personnes en maladie de longue durée s’accroit, le Service d’études de la Mutualité Chrétienne (MC) s’est posé la question suivante : comment ces personnes vivent-elles leur retour au travail ? En particulier, sont-elles victimes de comportements de discrimination lorsqu’elles reprennent le travail suite à une période d’incapacité ? Pour répondre à cette question, 506 membres de la MC concerné·es ont été interrogé·es à deux reprises via un questionnaire en ligne. Sur base des résultats obtenus, diverses recommandations ont été formulées afin de favoriser un retour au travail durable et de qualité.
Dans un contexte où la pression pour faire reprendre le travail aux personnes en maladie de longue durée s’accroit, le Service d’études de la Mutualité Chrétienne (MC) s’est posé la question suivante : comment ces personnes vivent-elles leur retour au travail ? En particulier, sont-elles victimes de comportements de discrimination lorsqu’elles reprennent le travail suite à une période d’incapacité ? Pour répondre à cette question, 506 membres de la MC concerné·es ont été interrogé·es à deux reprises via un questionnaire en ligne. Sur base des résultats obtenus, diverses recommandations ont été formulées afin de favoriser un retour au travail durable et de qualité.
 La gauche et les syndicats sont traversés par des débats – parfois larvés, parfois ouverts –autour de l’extension de Liege Airport, un aéroport de fret situé dans la province liégeoise, à Bierset. L’article suivant cherche à relever et discuter des différentes réponses déployées depuis les années 1990 jusqu’aujourd’hui par les syndicalistes de la FGTB et de la CSC quand ils sont confrontés à des dilemmes, comme dans le cas de l’aéroport, entre la préservation de l’environnement et celle de l’emploi.
La gauche et les syndicats sont traversés par des débats – parfois larvés, parfois ouverts –autour de l’extension de Liege Airport, un aéroport de fret situé dans la province liégeoise, à Bierset. L’article suivant cherche à relever et discuter des différentes réponses déployées depuis les années 1990 jusqu’aujourd’hui par les syndicalistes de la FGTB et de la CSC quand ils sont confrontés à des dilemmes, comme dans le cas de l’aéroport, entre la préservation de l’environnement et celle de l’emploi.
 La poursuite de l’augmentation continue de la production et de la
La poursuite de l’augmentation continue de la production et de la
productivité se fait au détriment du vivant, des écosystèmes et exacerbe
les inégalités. Le droit social présente un rapport très ambivalent au
productivisme. D’une part, il fait vraiment partie de ce modèle productiviste, et le soutient au nom de l’emploi et de la croissance économique. Mais on y trouve aussi des mécanismes qui reposent sur d’autres rationalités que la logique productiviste et qui peuvent donc être mobilisés par les syndicats pour essayer de la contrecarrer, et de favoriser la transition écologique.
 À l’heure où les politiques d’emploi convergent vers un
À l’heure où les politiques d’emploi convergent vers un
durcissement pour les personnes sans emploi et les organismes
qui les accompagnent, il importe de revenir sur les conséquences
psychosociales du chômage et sur le travail social opéré par les
centres d’insertion. À rebours des discours à l’emporte-pièce
et des orientations politiques actuelles, voici une synthèse des
résultats de plusieurs études approfondies et éclairantes.